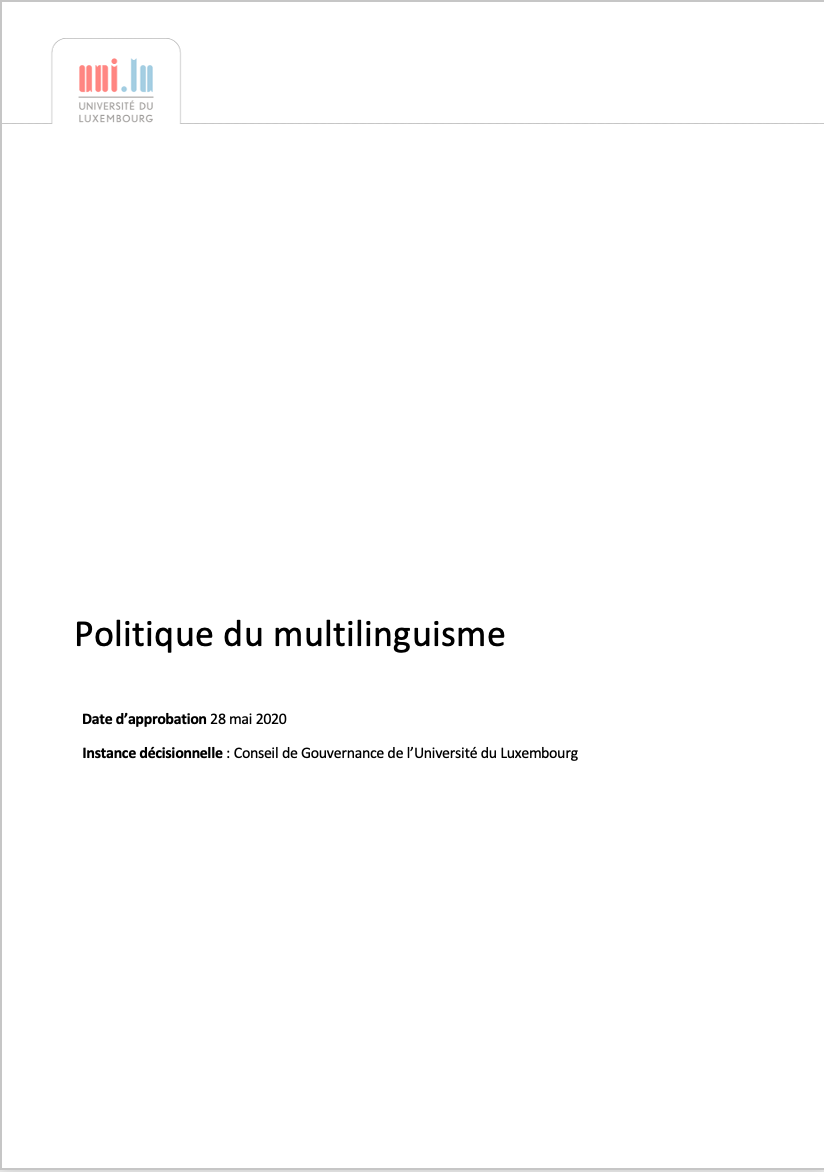Écouter cet article
La cohabitation entre les trois langues du pays y relève de l’équilibrisme, entre volonté d’inclusion et nécessité d’ouverture à l’international.
Trilingue par héritage, le Grand-Duché assume devoir jongler entre le luxembourgeois, le français et l’allemand. Les contours traditionnels des trois langues sont toutefois bousculés par l’évolution de la société et la place que le pays s’est façonnée dans le monde. L’anglais s’offre désormais une place de choix dans les relations économiques mais pas seulement.
Si le multilinguisme demeure une formidable chance et un atout incontournable pour le pays, il n’en constitue pas moins un défi à appliquer dans l’enseignement supérieur. Le découpage linguistique en vigueur dans le fondamental et le secondaire disparaît une fois passé l’examen de fin d’études secondaires et laisse la place à la décision discrétionnaire de l’établissement.
Agathe*, 18 ans, est inscrite dans l’un des 30 BTS accrédités au Grand-Duché. Française et frontalière, elle ne comprend pas le luxembourgeois, ce qui n’aurait pas dû poser de difficulté puisque sa formation est censée être enseignée dans la langue de Molière. Sauf que les professeur·e·s tendent à parler plutôt en luxembourgeois, langue maternelle de la plupart des élèves. « Nous avons été obligés de leur demander de parler en français », explique Agathe. « Les professeurs ont accepté, mais cela ne plaît pas aux autres élèves. »
Trois mois après la rentrée, les cours se déroulent en grande partie en français ou alors l'enseignant, s’il s’exprime en luxembourgeois, veille à répéter en français pour les francophones de la classe. Mais l’ambiance de la classe en a pris un coup. « Nous avons essayé de nous mélanger avec les autres élèves mais ils restent entre eux », déplore Agathe. « Nous entendons encore beaucoup de remarques désagréables en classe et en dehors. »
Une situation difficile à vivre pour la jeune femme et ses camarades français·es. « Les premières semaines, j’ai beaucoup pleuré, c’était dur. Il y avait des matins où je ne voulais pas y aller. Mais nous nous entraidons. » Quant aux enseignant·e·s, « ils disent aux autres d’arrêter de parler ou de rire en cours mais n’interviennent pas à propos des moqueries ».
« Le choix des langues d’enseignement devrait se faire en fonction des besoins du terrain »
Christiane Huberty, conseillère de gouvernement, ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche assure « ne pas avoir eu écho » de telles tensions entre élèves. « Si de telles situations se produisent, il appartient à l’étudiant d’en parler à la direction du lycée », indique Christiane Huberty, conseillère de gouvernement chargée de la coordination de l’enseignement supérieur. « Il arrive que des étudiants contestent le résultat d’un examen et déposent un recours gracieux, auquel cas nous demandons un rapport au lycée, mais nous n’avons jamais été saisis jusqu’à présent concernant une situation conflictuelle en matière de langue. »
Soucieux de ne pas briser l’anonymat d’Agathe*, le Lëtzebuerger Journal n’a pas interrogé son établissement, mais l’École de commerce et de gestion, qui met en avant trente années d’expérience dans les formations bac +2. « Aucune tension ne m’a été rapportée », assure son directeur Joseph Britz. « Comme partout, des groupes se forment mais il y a quand même une bonne entente. »

Douze établissements, dont le Lycée technique des arts et métiers, se partagent les 30 BTS dispensés dans le pays.
De fait, la langue d’enseignement des BTS n’est pas choisie de manière verticale et centralisée par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche comme c’est le cas dans le secondaire sous la tutelle du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse. « Le ministère est chargé d’accréditer les programmes de BTS élaborés par des groupes curriculaires composés d’enseignants du lycée dont émane le projet et de représentants du milieu professionnel concerné », explique Mme Huberty. Une accréditation valable cinq ans pour laquelle le feu vert est donné par un comité indépendant comprenant des expert·e·s des matières concernées, des expert·e·s de l’assurance qualité au niveau de l’enseignement supérieur et des représentant·e·s de la profession visée. Objectif prioritaire : « le titulaire d’un BTS devrait pouvoir rejoindre tout de suite la vie active », précise Mme Huberty.
Les langues sont un des critères de validation du ministère. « Le choix des langues d’enseignement devrait se faire en fonction des besoins du terrain », souligne Mme Huberty. « C’est l’approche que soutient le ministère. Et de façon générale, pour le Luxembourg, il est clair qu’on ne peut pas se passer du multilinguisme. »
L’anglais, un rival incontournable
Parmi les trente BTS dispensés par 12 établissements habilités, la quasi-totalité est dispensée au moins en français, auquel s’adjoint de plus en plus l’anglais, par exemple et très logiquement dans les domaines du tourisme et de l’hôtellerie ou encore de l’informatisation et de la digitalisation. L’allemand se fait encore une place dans les BTS dédiés à l’artisanat.
« Le français demeure la langue principale au Luxembourg pour l’administratif », abonde M. Britz, « mais nous ajoutons de plus en plus d’anglais dans nos BTS économiques et administratifs car cette langue prend de l’importance. Il est absolument nécessaire que nos jeunes sachent s’exprimer correctement en anglais avec les termes administratifs appropriés. »
Quant au luxembourgeois, il n’est généralement pas langue véhiculaire sauf besoins spécifiques comme dans le BTS de media writing destiné aux journalistes en herbe. Ce dernier propose même un cours de luxembourgeois afin de permettre aux francophones d’apprendre la langue et aux autres d’en maîtriser l’écriture. Hormis cette exception, aucun examen ne se passe dans la langue de Dicks.
L’origine des étudiant·e·s joue également dans ce choix. « Les cours ne peuvent être donnés en luxembourgeois, sinon les étudiants francophones ne pourraient pas les suivre », constate M. Britz. Or ces recrues frontalières – mais aussi résidentes – nourrissent ces formations : elles représentent 28% des inscrits en BTS commerce et marketing et 10% des effectifs du BTS comptabilité à l’ECG. Des étudiant·e·s qui se destinent au marché du travail luxembourgeois et souhaitent mettre toutes les chances de leur côté en présentant un diplôme du cru.
« Un atout, une force et un challenge » pour l’Uni
Ouverture et diversité guident également la politique linguistique de l’Uni, fer de lance de l’enseignement supérieur du pays avec un effectif de 6.000 étudiant·e·s. « Nous voulons que l’université reflète le caractère multilingue du pays et nous savons qu’il est très important d’être multilingue pour l’employabilité de nos étudiants au Luxembourg et à l’étranger », affirme Catherine Léglu, vice-rectrice académique de l’Uni.
L’Uni a d’ailleurs couché noir sur blanc sa « Politique du multilinguisme », élaborée par un groupe de travail ad hoc et approuvée par son conseil de gouvernance. Par principe, l’Uni reconnaît quatre langues : l’allemand, le français, l’anglais et le luxembourgeois. « Chacune de ces quatre langues a un rôle particulier à l'Université, découlant de sa position en tant que langue académique, juridique ou nationale, du contexte de recherche disciplinaire ou des spécificités d'un programme d'enseignement », affirme le document de 12 pages.
L’anglais, le français et l’allemand sont les principales langues d’enseignement, tandis que le luxembourgeois apparaît seulement dans certains programmes des sciences humaines et sociales. Comme pour les BTS, c’est la réalité professionnelle qui dicte l’usage linguistique de chaque cursus. « Il est par exemple absolument essentiel pour un étudiant en sciences de l’éducation se destinant à l’enseignement fondamental de maîtriser le français, l’allemand et le luxembourgeois », indique Mme Léglu. « Et le droit étant écrit en français, le bachelor en droit s’enseigne essentiellement dans cette langue. » Avec quelques spécificités puisque l’allemand est requis pour un·e étudiant·e souhaitant s’orienter en criminologie, ne serait-ce que parce que c’est la langue des rapports de la police grand-ducale. De même pour les futur·e·s ingénieur·e·s probablement amenés à travailler côté allemand, même si l’anglais reste central.
« Très peu d’universités sont réellement multilingues », souligne Mme Léglu. Car pour qu’un programme soit considéré comme tel, il faut que chacune des trois langues représente au moins 20% de l’enseignement. Les pays souvent loués pour l’ouverture linguistique de leurs universités, comme les Pays-Bas ou les pays scandinaves, ne proposent souvent que des programmes bilingues combinant l’anglais et la langue nationale.
« Le multilinguisme est un atout, une force et un challenge – et j’espère pas une faiblesse », estime Mme Léglu, consciente que ce critère attire des étudiants autant qu’il peut en effrayer. Il en est de même pour les enseignant·e·s-chercheur·euse·s devant maîtriser au moins l’anglais et s’engager, s’ils·elles ne parlent ni français, ni allemand, « à apprendre dans les trois ans une des deux langues au niveau B2 minimum du Cadre européen commun de référence pour les langues s'ils souhaitent être considérés pour une promotion ou un contrat permanent », précise la politique linguistique de l’Uni.

Quant aux étudiant·e·s, « ils doivent présenter des compétences avérées ou plusieurs années d’apprentissage scolaire pour être admis dans un cursus », ajoute Mme Léglu. À ce niveau d’études, le profil des étudiant·e·s moins bien loti·e·s change par rapport au BTS. « Certains étudiants des bachelors en français se plaignent qu’il y ait beaucoup d’étudiants venant de la Grande Région, parfaitement francophones, alors qu’eux-mêmes apprécieraient que le professeur passe plus de temps sur certaines explications », rapporte-t-elle. « C’est au professeur de garder en tête qu’il n’enseigne pas dans un milieu 100% francophone et qu’il faut davantage expliquer le vocabulaire technique. »
Surtout qu’en master sont inscrits des étudiant·e·s diplômé·e·s d’universités allemandes qui ne trouvent aucune langue maternelle parmi celles utilisées sur le campus. « Cela se passe bien en principe, mais ils ont besoin de soutien et d’explications », souligne Mme Léglu. Des cours de langue technique sont d’ailleurs dispensés, en économie par exemple.
Les professeur·e·s sont également invité·e·s à expliquer les modalités du cours et de l’examen en français et en anglais afin de s’assurer que tou·te·s les étudiant·e·s les aient bien compris. « Il y a parfois des tensions, notamment dans des cours dispensés dans une langue qui n’est la langue maternelle ni des étudiants ni du professeur », admet Mme Léglu, qui met en avant le « partage de l’apprentissage » que cela peut générer. « Le travail en groupe est souvent assez utile, en particulier pour les étudiants moins confiants dans une langue. Cela amène à la fois de l’entraide et une occasion de se forcer à s’exprimer. »
Un modus vivendi confirmé par une étudiante française en 3e année de droit. « Les cours sont à 60% en français et 40% en anglais. Beaucoup sont français dans ma promotion mais tout le monde a un assez bon niveau d’anglais. Le tout premier cours de droit en anglais n’était pas évident à suivre – sans avoir jamais fait de droit ni connaître le vocabulaire juridique en anglais… Mais si nous avons des difficultés à comprendre, nous pouvons aller voir le professeur pour redemander des explications. »
La tentation de l’entre-soi
Même constat du côté de Denis Scuto, professeur associé et responsable de l’histoire contemporaine du Luxembourg au sein du Centre d’histoire contemporaine et digitale (C2DH). « Je n’ai jamais rencontré de difficultés. Certains étudiants ont parfois des problèmes avec la langue, notamment ceux du programme Erasmus, et prennent des cours de langue à côté. Il arrive aussi que des Français aient des difficultés avec l’anglais en master. » Quant au luxembourgeois, « cela peut m’arriver de m’exprimer dans cette langue si un groupe de travail est composé de Luxembourgeois, mais que le luxembourgeois soit une langue véhiculaire n’est ni possible ni d’ailleurs souhaitable. Le bilinguisme se développe de plus en plus dans le monde universitaire mais le multilinguisme est la spécificité et la force du Luxembourg. »
Ce multilinguisme met finalement tout le monde sur un quasi-pied d’égalité : enseignant·e·s et étudiant·e·s sont souvent amené·e·s à donner ou suivre un cours dans une langue autre que leur langue maternelle. « Et pour les examens, les étudiants peuvent choisir la langue dans laquelle ils veulent s’exprimer », indique M. Scuto.
Telle est la chance et le défi du Grand-Duché : défendre son multilinguisme, clé de son ouverture et de son attractivité, tout en veillant à une présence équilibrée de chaque langue officielle face au rouleau compresseur de l’anglais. « Nous ferions une faute grave en ignorant le rôle de plus en plus important de l’anglais, mais nous ne nous tournerons jamais à 100% vers l’anglais », note M. Britz. « Nous sommes au Luxembourg, nous vivons du multilinguisme et nous en avons besoin. » Le tout en essayant d’intégrer tous les étudiant·e·s, qu’ils·elles soient luxembourgeois·es, français·es, allemand·e·s ou d’autres nationalités, alors que la tentation de l’entre-soi est grande.
*Le prénom a été changé pour préserver l’anonymat de cette étudiante.